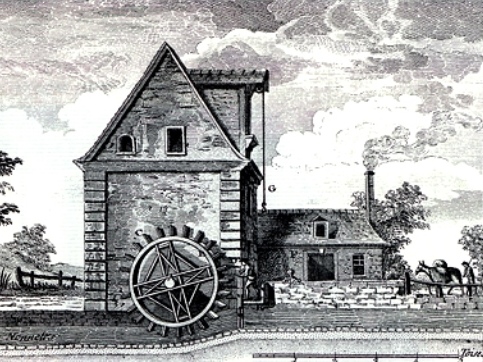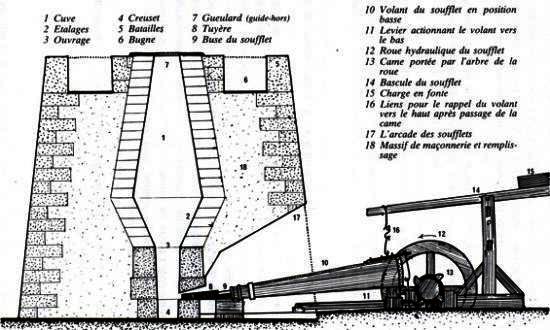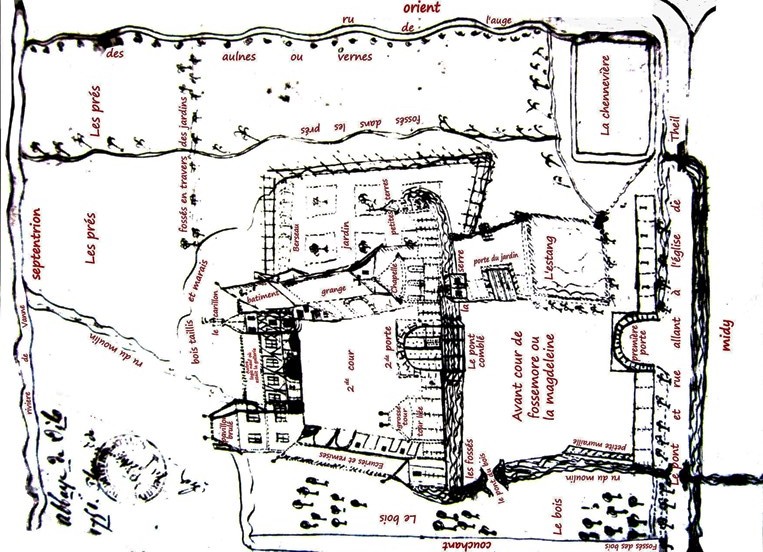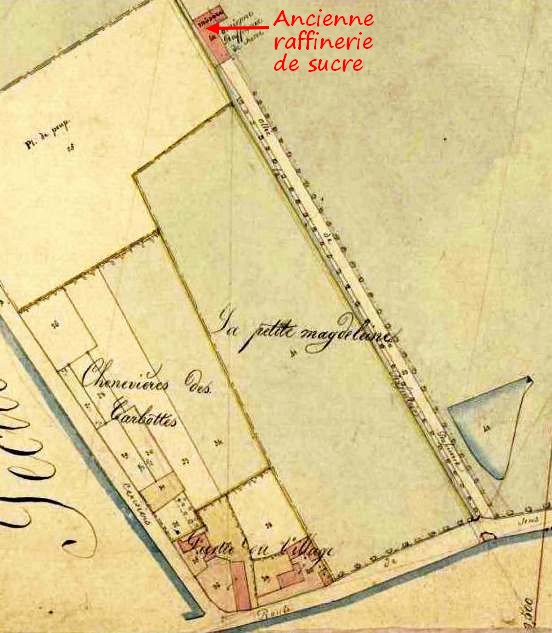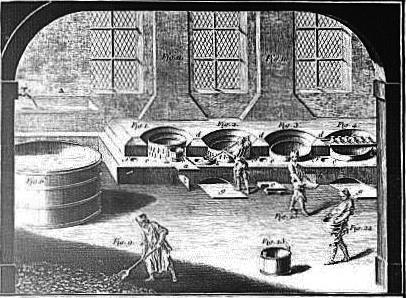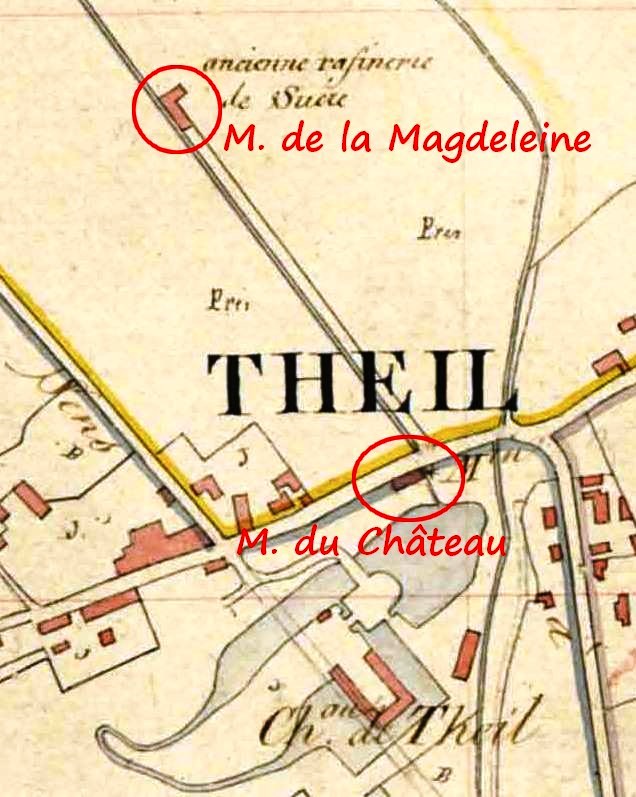Lorsqu'on
parle de Fossemore, c'est l'Abbaye des moines de Dilo qui vient
immédiatement à
l'esprit. En réalité Fossemore semble représenter la vallée de la
Vanne à Theil entre la source Saint Philbert et le moulin de la Forge.
Plusieurs moulins ont porté ce nom: celui de
l'abbaye de Dilo (La Magdeleine) mais aussi celui des Hospîtaliers de
Cerisiers (La Forge).
|
|
Dès 1139, un prénommé
Foulques donna sa terre de
Fossemore à l’abbaye de Dilo (cartulaire de l'Yonne).
De 1145 à 1184 les
bâtiments abritèrent
un monastère de femmes dépendant des Prémontrés de l'abbaye Notre Dame
de l'Assomption de Dilo et une
maladrerie.
Divers dons sont faits à
cette époque. En 1154, Anseau Pocher, son épouse Rotznide et leur fils
Mainard
donnent ce qu’ils ont à la fontaine Saint-Philibert (à Pont-sur-Vanne)
jusqu’à la voie des Sarazins qui mène au moulin des Echarlis, et ce
qu’ils ont dans la forêt de Vareilles, pour établir leurs filles
Sanaolde et Christine .
Ces religieuses avaient
une grande dévotion pour Sainte
Madeleine perpétuée par les noms de lieu entourant l'abbaye: fief de la
Madeleine, chapelle
Sainte Madeleine, ru de la Magdeleine, La petite Magdeleine...
Passé 1184, on ne voit
plus les religieuses s’activer à Theil.
Pour autant, leur patrimoine n’est pas dilapidé. Les moines de Dilo
ont repris en main le domaine.
|

Un Prémontré au XVIIème siècle
|
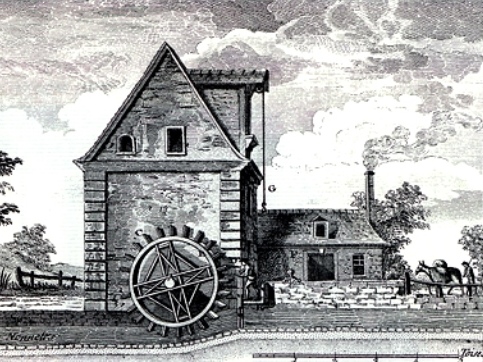
|
Nous n’avons pas de trace de moulin avant 1262 date du
conflit avec le couvent des Echarlis.
Conflit entre les
Escharlis et l’abbaye de Dilo
En 1262 Les Eschalis et l’abbaye de Dilo concluent un
accord pour
l’usage des eaux du ruisseau de Fossemore (archives de l’Yonne H635).
Le résumé effectué par le rapporteur du couvent des Eschalis se résume
ainsi :
Il y a deux sujets de contentieux touchant les moulins de Fossemore et
de Vaumorin. L’un des différents que nous avons avec l’abbé Hambard du
couvent de l’abbaye de Dei Loci , Lieu Dieu, touche l’eau que nous
prenions pour notre moulin. Il est dit que nous ne pouvons plus avoir
qu’un pied de dénivelé d’eau comme anciennement et que l’eau de
décharge partirait pour abreuver les prés et que l’on curerait la
rivière à frais communs.
|
En 1350, en pleine guerre de cent ans, le bailli de
Sens avec quelques
nobles du voisinage ordonna d’abattre tout ce qui pouvait servir
d’asile à l’ennemi.
C’est ainsi que furent détruits le moulin des
moines de Dilo et leur maison de Fossemore .
|
A partir de 1456 et pendant plus de soixante ans, les
lieux furent
transformés en une usine destinée à traiter le minerai de fer.
De 1456
à 1528 en ce moulin un soult à faire fondoire
Au cours du XIVe siècle,
une innovation voit le jour dans l'extraction du fer du minerai: la
force
hydraulique. Elle est utilisée pour la ventilation des foyers des bas
fourneaux.
L'utilisation de
roues à aubes ou à godets en remplacement de la force humaine permet
d'augmenter la puissance des vents et d'en assurer la régularité. Ceci
permit l'augmentation de la
hauteur des fours jusqu'à atteindre quatre à cinq mètres.
|
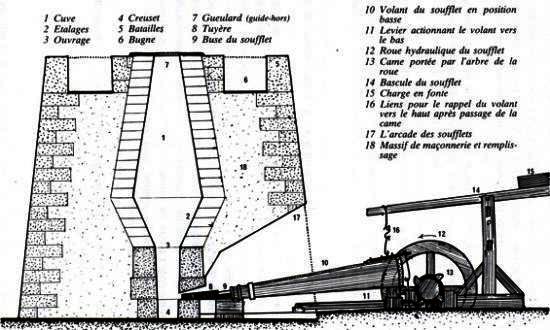
|
Avec un fourneau de cette
hauteur et
les températures permises par les nouveaux soufflets, le fer une fois
réduit se combinait au carbone, produisant de la fonte, dont la
température de fusion (environ 1200°) est nettement inférieure à celle
du fer pur.
On obtenait donc de la
fonte liquide au bas du fourneau, et
non plus la loupe de fer pâteux qu'il fallait jusque là extraire du
bas-fourneau pour l'amener à la forge.
|

Musée du fer de Nancy
|
En 1456 deux baux furent
signés avec Jehan Remi pour créer une métallurgie à Fossemore
Jean Gondard,
Abbé de Dilo, confie à Jehan Remy «maître
et gouverneur des forges et moulins de Fossemore», par bail à
quatre
vies et les 19 ans suivant la quatrième vie, "un soult à faire fondoëre , au lieu
dit le moulin, ensemble le minerai à prendre pour lui et ses ouvriers,
en tous les bois il pourra prendre pierres pour y construire le
fourneau de la dite mine moyennant 12 livres de rente"
C'était la nouvelle
technique des
hauts fourneaux qui s'implantait dans la région.
La même année, en
1456, l'Hospital de
Cerisiers baille à Jehan Remy le moulin et la forge sur la Vanne.
(futur moulin de La Forge)
Ainsi Jehan Remi
regroupait entre ses mains l'extraction du métal et son façonnage.
Cette métallurgie exista au moins jusqu'en 1528
|
En 1515, sur injonction de
Cochivon, sergent de la châtellenie de
Malay le Roy on effectue un inventaire des biens de Fossemore. On
dénombre : l’église et les bâtiments les bois et buissons, Champfétu,
la grange de Vaultrognon. Le total étant estimé à 600 arpents.A cela
s’ajoute une place à faire moulin et 60 sols de créances.
Le lieu-dit fut habité dès
1570 et le fief fut érigé en
1586.
En 1586, l’abbaye de Dilo
est taxée pour subvention (la sixième
taxation par Charles IX), l’abbé commendataire, nommé par le parti
royaliste, vend le droit de reversion sur la terre de Fossemore à
Louise de la Rivière moyennant 279 écus d’or sol et 20 livres de rente
annuelle.
Le 16 juillet 1631, l’abbé
commendataire Henri de Vignoles
(1626-1663), par ailleurs vicaire général de Sens, obtient un arrêt du
Parlement de Paris portant qu’à l’expiration des 99 ans, l’abbaye
rentrerait en possession de cette terre en remboursant le prix de
l’aliénation et les «loyaux coûts ».
|
Gédéon I° de Conquérant,
seigneur de Gondreville, se fait déclarer « propriétaire in
commutable » par un arrêt obtenu par surprise, en déclarant que les
religieux n’avaient pas satisfait à l’arrêt de 1631 puisqu’ils
n’avaient pas remboursé le prix principal de l’aliénation.
Les religieux ne
l’entendent pas ainsi et le 16 juillet 1648, il est établi un dossier
des pièces concernant les points de contestation entre les religieux et
les Sieurs de Conquérant.
L’affaire est plaidée sans
grand résultat, pendant plus de cent ans, mais finalement le 20
septembre 1751, on trouve un accord sur les sommes encore dues aux de
Conquérant. Les arrêts de 1642 et 1643 seront pleinement exécutés et
les moines réintègreront Fossemore.
En 1751, curieusement,
parallèlement à cette action, Mr de Sérilly acquiert auprès de la
famille de Conquérant le fief de Dilo à Chigy .
Mais ce n’est qu’en 1759
qu’un accord définitif intervient : les moines devront payer 2.000
livres par an pendant 18 ans. Qu’advint-il ensuite ? Il semble qu’à la
révolution, la Madeleine ne fasse plus partie des biens de Dilo,
puisqu’elle n’est pas inventoriée, ni vendue comme bien National.
Il faudrait de plus amples
recherches pour connaître son devenir. Mais , comme, en 1786 et 1787,
Mr de Sérilly passe un très grand nombre de baux à ferme et qu’en 1821
il crée une sucrerie dans le moulin de La Madeleine, tout nous porte à
croire que les « de Sérilly » ont réussi à mettre la main sur la
Madeleine et ses dépendances, soit avant, soit après la
révolution.
|
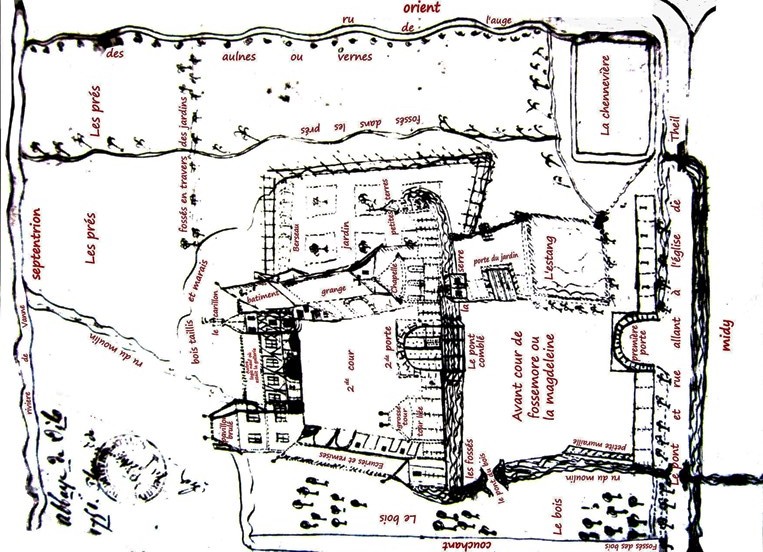
Plan du château de l'abbaye de Dilo (1751)
|
Depuis 1791, la flotte
anglaise
imposait un blocus maritime, qui avait rendu difficile le
ravitaillement en sucre en provenance de nos colonies.
Au début de 1811, une
commission de
l'Académie des Sciences publiait une « instruction sur la fabrication
du sucre de betterave » faisant le point de la question.
Huit jours plus tard,
Napoléon
ordonna, par un décret en date du 29 mars 1811, qu'une superficie de
cent mille arpents (40.000 hectares) fût réservée à la culture de la
betterave.
|
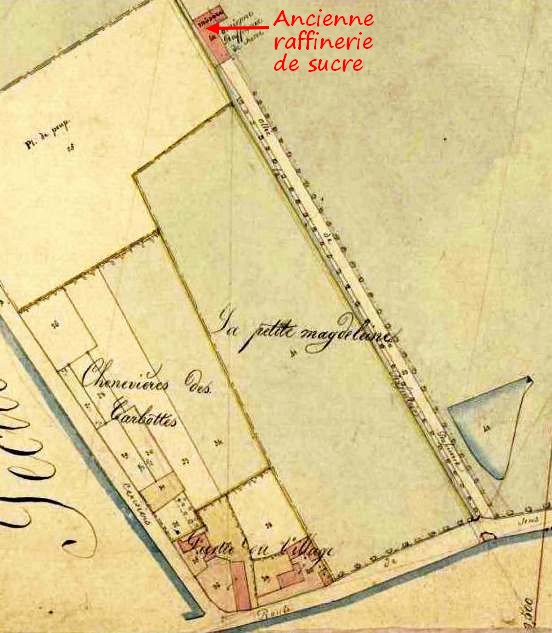
Emplacement de l'ancienne sucrerie
(cadastre napoléonien de 1835)
|
A la chute de
l'Empire, plus de 200 sucreries étaient en activité et produisaient au
total de 2 à 3 000 tonnes de sucre. Le commerce maritime reprit, et le
sucre de canne de nos colonies envahit à nouveau nos marchés, faisant
chuter le cours du sucre. Mais la récession ne va pas durer.
En 1821 la
consommation de sucre était de 1,4 Kg par an et par habitant. Elle va
exploser. (35 Kg aujourd’hui par an et par habitant). Les besoins de la
France vers 1820 étaient donc de 42 000 tonnes pour 30 millions
d’habitants.
C’est
dans ce contexte que la famille Mégret de Sérilly construit une
fabrique de sucre en 1821.
Dans les archives de la
famille Thomas de Pange au
Service départemental d’archive de la Moselle, il est répertorié un
acte d'association concernant, Armand-François Mégret de Sérilly, pour
la création d’une fabrique de sucre, établie à Theil.
La fabrication du sucre
exige d'énormes quantités d'eau (un m3 d'eau
pour une tonne de betteraves traitées).
M. de Sérilly implante sa
fabrique dans le moulin de la Madeleine de
l’ancienne abbaye de Dilo, à proximité du ru du moulin qui lui fournira
son eau et son énergie.
Armand-François Mégret de
Sérilly décède en 1826. Il sera inhumé à
Theil.
|
En 1833 l’avis de
fermeture de la fabrique de sucre est ainsi
entérinée :
"Il est regrettable que la fabrique de
sucre de betterave établie à
Theil, il y a dix ans, par M. de Sérilly, ne fonctionne plus. Elle
occupait au moins 25 personnes pendant l’hiver.
Le sucre, d'un goût particulier, était recherché par les confiseurs et
restaurateurs de Paris.
Le pays de Pont-sur Vanne fournissait
beaucoup
de betteraves de très belle qualité.
Plus d'un arpent de terre eut
rapporté annuellement 300 fr. au moins et si la sucrerie eut continué,
les terres eussent été vendues au poids de l'or."
|
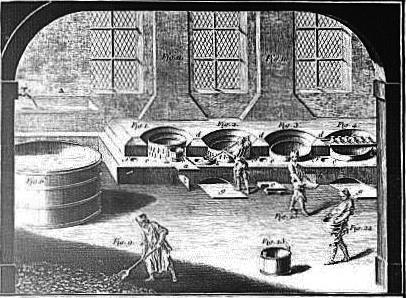
Chaudières de fabrique de sucre
|
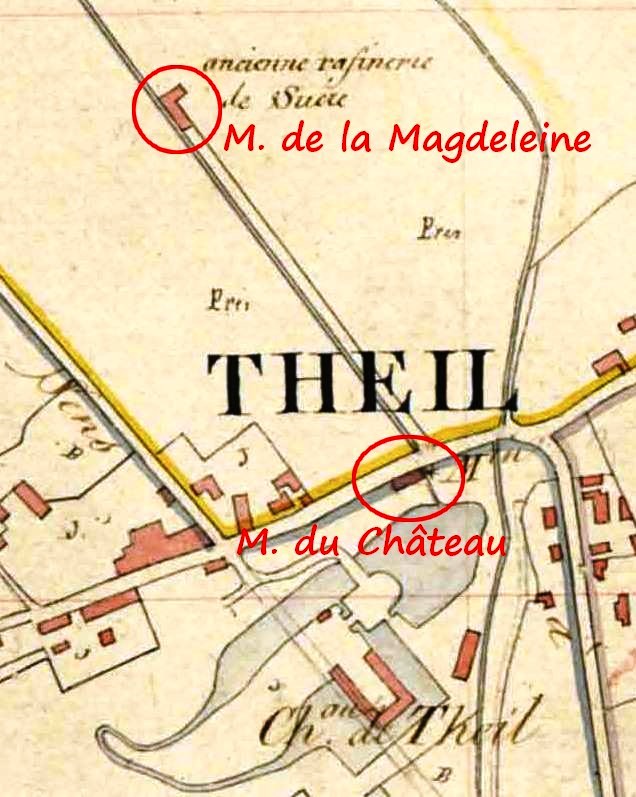
|
La sucrerie de Theil fut rachetée par Monsieur Boureau
qui, en 1839, la
retransforma en moulin à farine.
Moulin du Château
contre moulin de la Magdeleine
Extraits de la lettre du juge de Villeneuve
l’Archevêque nommant un
expert le 8 janvier 1840.
M. Boureau acquit la sucrerie de Theil et la transforma
en 1839 en
moulin à farine.
Son plus proche voisin était M. Lecrocher, lui aussi
propriétaire du moulin du Château qu’il avait acheté à Mlle de Sérilly.
« M. Boureau aurait
fait sur le ruisseau qui alimente son moulin des
travaux qui feraient refluer les eaux jusque sous la roue du moulin de
lui M. Lecrocher et qui empêcherait son usine de fonctionner aussi
librement que par le passé. Circonstance qui lui amènerait un
préjudice.
La mise en farine du
moulin de M. Boureau n’a eu lieu que
depuis moins d’un an, une demande en trouble de possession a été formée
contre lui. »
Un décret royal du 20 juin
1842 fixe les conditions d’utilisation du
moulin :
|
"Nous avons ordonné et ordonnent ce qui
suit :
Article
1
Le sieur Boureau est autorisé à maintenir en activité le moulin à blé
qu’il a rétabli sur le ruisseau de la Madeleine à Theil département de
l’Yonne.
Il est autorisé en outre à dériver de la rivière la vanne, les eaux
nécessaires pour augmenter la force motrice de ce moulin en recueillant
sur le passage de son canal, toutes celles des rus de Saint Philibert
et de Loye.
Article
2 l’eau du ruisseau de la Magdeleine pourra être relevée par le
permissionnaire a un niveau tel que sa surface, à 25 mètres en aval du
pont sur lequel la route n°5 traverse ce ruisseau, affleurera
exactement le dessus d’une borne en grès à rive gauche à 2 mètres et 21
cm en contrebas du dessus du bahud de la tête amont du ponteau et à
1métre et 56 cm en contrebas du dessus du cordon en briques qui règne
sur le premier étage du bâtiment du moulin…
(évidemment
!!!)
Article 18 faute pour le sieur Boureau de
se conformer exactement aux
dispositions de la présente ordonnance ,le moulin sera mis en chômage
par un arrêté du préfet, sans préjudice de l’application des lois…
signé : Louis-Philippe
Le 10 janvier 1845 est
dressé un procès-verbal,
selon lequel les travaux prévus dans l’ordonnance du 20 juin 1842 ne
sont pas réalisés.
Le moulin est mis en
chômage immédiatement et la clé
du cadenas confiée au maire.
Entre temps M. Boureau
avait revendu son
moulin au sieur Corpechot.
Aujourd’hui, 170 ans plus
tard, c’est la ferme de Lionel Languillat.
|

L'ancienne propriété des Moines de Dilo, aujourd'hui.
|
Vous pouvez
découvrir l'ensemble des articles sur
Fossemore, la
métallurgie à Theil, la guerre des Moulins, la sucrerie...
dans notre bulletin N°13 "Au courant de la Vanne" de
décembre 2013.
|
|